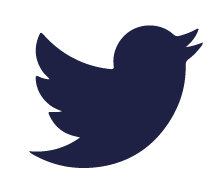GT environnement du CSF Infrastructures Numériques
L’AFNUM est heureuse de vous partager le livrable d’écoconception des équipements réseaux.
Réalisé conjointement avec Infranum et Sycabel, il s’inscrit dans le cadre de la deuxième saison du contrat de filière du Comité Stratégique de Filière « Infrastructure numérique » qui a pour objectif de construire des territoires connectés et durables.
L’écoconception des équipements réseaux
La transformation numérique de nos sociétés s’accompagne d’une croissance soutenue de la demande en infrastructures de connectivité. Cette évolution, bien qu’indispensable à la transition économique et sociale, engendre des impacts environnementaux significatifs : consommation d’énergie, extraction de matières premières, émission de GES, production de déchets électroniques et tensions sur les ressources en eau.
Dans ce contexte, l’écoconception s’impose comme une réponse stratégique et systémique pour réduire l’empreinte environnementale des équipements réseaux, tout en anticipant les futures exigences réglementaires, économiques et industrielles. Elle consiste à intégrer des critères environnementaux dès la phase de conception d’un produit, en tenant compte de l’ensemble de son cycle de vie.
De nombreux fabricants se sont déjà engagés dans des démarches concrètes qui montrent que les actions d’écoconception sont aussi un levier de performance industrielle, de compétitivité et d’optimisation économique. Pour autant, les démarches restent aujourd’hui fragmentées. Les référentiels techniques sont encore en cours d’harmonisation et les freins économiques, technologiques et concurrentiels pèsent sur la capacité des industriels à investir durablement dans cette transformation. L’un des défis majeurs tient à l’absence d’un cadre d’évaluation lisible, partagé et opérationnel.
L’ambition de ce document est de proposer une lecture claire, structurée et opérationnelle de ces enjeux, en identifiant les leviers d’écoconception mobilisables à chaque étape du cycle de vie, les freins persistants à leur déploiement et les conditions d’un passage à l’échelle, au service d’une filière plus durable, compétitive et résiliente.
Les axes d’écoconception
Vous trouverez l’ensemble des enjeux liés à l’écoconception des équipements réseaux, axes, leviers, freins et recommandations en téléchargeant le document.